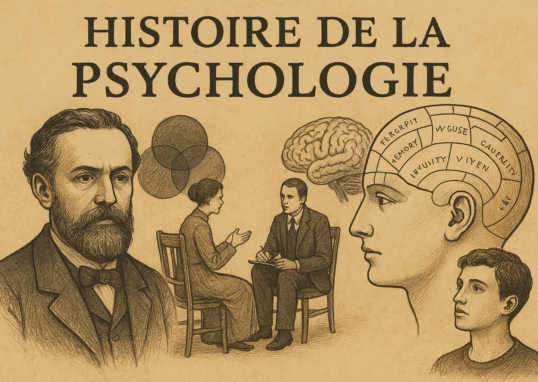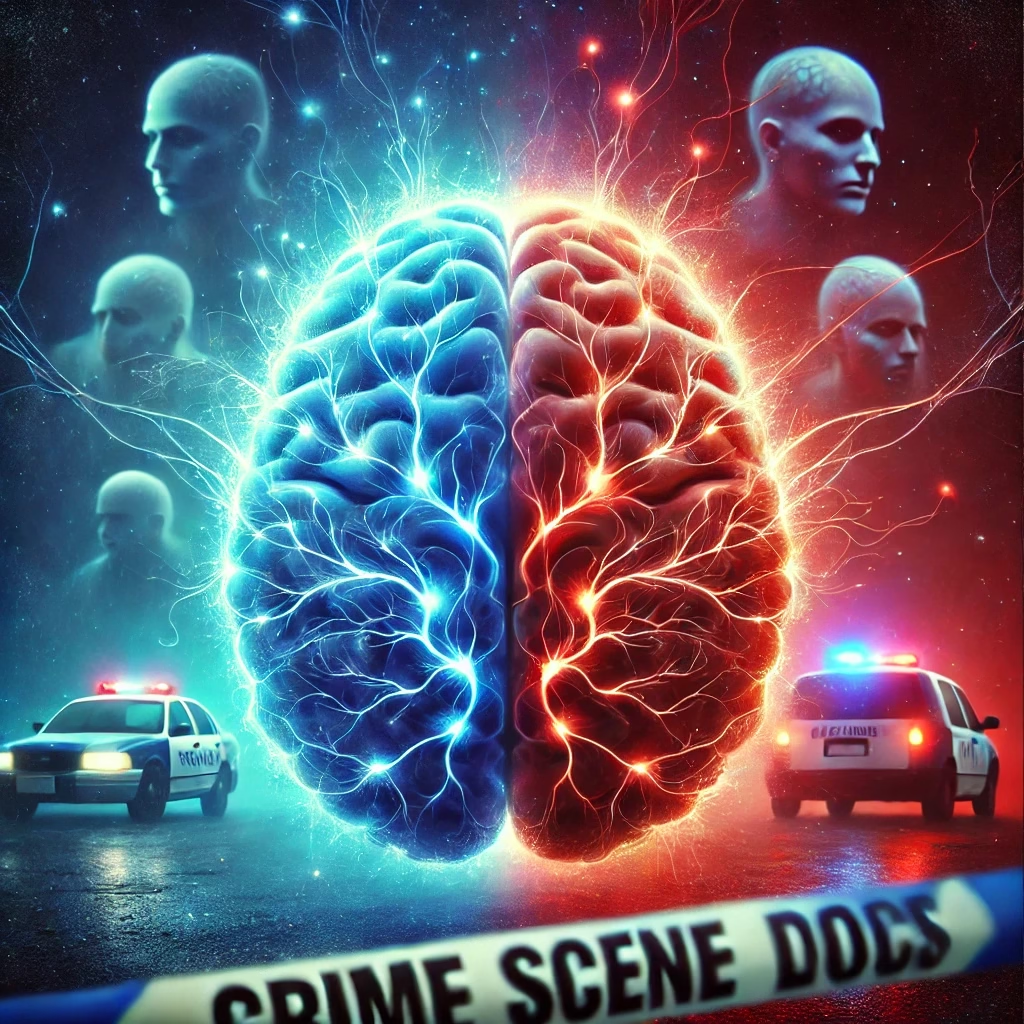
Quand on parle des tueurs en série, on imagine souvent des monstres froids, des êtres dénués d’humanité, ou des génies du mal. Mais si la réalité était moins romanesque et plus biologique ? Et si, derrière leurs actes, se cachait un dérèglement profond de leur cerveau, notamment du circuit dopaminergique, ce système clé qui régit le plaisir, la récompense et la motivation ?
Le circuit dopaminergique : un moteur de plaisir et d’addiction
Le circuit dopaminergique, c’est un peu comme le chef d’orchestre de nos envies et de nos plaisirs. Il s’active quand on mange un bon repas, quand on reçoit un compliment, ou quand on atteint un objectif. Ce système, qui implique des régions comme le noyau accumbens et l’aire tegmentale ventrale, libère de la dopamine, un neurotransmetteur qui nous fait sentir bien et nous donne la motivation de recommencer. Cependant, cette motivation peut dans certains cas agir comme une envie irrépressible (voir l’article sur les addictions). Les recherches montrent que des dérèglements dopaminergiques sont souvent associés à des comportements addictifs (Volkow et al., 2011). Et si, chez certains tueurs en série, tuer devenait une forme d’addiction, une quête désespérée de « shoots » de dopamine ?
« Attends, tu veux dire que tuer pourrait être comme une drogue pour eux ? »
Exactement, Laurent. C’est une hypothèse sérieuse. Mais avant d’aller plus loin, il faut comprendre comment ce circuit peut se dérégler.
Les dérèglements dopaminergiques : une quête de sensations extrêmes
Chez une personne neurotypique (fonctionnement neurologique dans la norme), le circuit dopaminergique s’active face à des stimuli sociaux ou naturels. Mais chez certains individus, il peut être hypo-sensible ou hypersensible. Une hypo-sensibilité, par exemple, signifie que les plaisirs ordinaires – un film, une discussion – ne suffisent pas à déclencher une réponse suffisante. Ces personnes peuvent alors chercher des sensations plus intenses pour compenser (Buckholtz et al., 2010). Tuer, planifier un crime, ou exercer un contrôle total sur une victime pourrait devenir une source de stimulation extrême, un moyen de provoquer une décharge massive de dopamine.
Des études sur les psychopathes – un trouble de la personnalité que l’on retrouve souvent chez les tueurs en série – montrent qu’ils présentent des anomalies dans le circuit de la récompense. En 2013, un chercheur nommé Blair met en évidence que les psychopathes ont une activité accrue dans les régions dopaminergiques lorsqu’ils anticipent une récompense, mais une faible réponse émotionnelle aux conséquences négatives de leurs actes. Si l’on devait imaginer leur cerveau comme étant une balance, le plaisir de l’acte est beaucoup plus lourd que toute forme de culpabilité ou de peur.
« Mais tout le monde n’a pas envie de faire des trucs horribles, même avec un cerveau qui marche mal, non ? »
On est bien d’accord ! Le dérèglement dopaminergique n’explique pas tout. Il faut aussi regarder du côté des facteurs émotionnels, comme l’incapacité à ressentir de l’empathie.
Le déficit d’empathie et le rôle des émotions
Un dérèglement dopaminergique ne transforme pas quelqu’un en tueur en série du jour au lendemain. Mais il peut amplifier des traits préexistants, comme un déficit d’empathie.
! Il me semble important de pouvoir faire une mise au point !
Dans le cas de la psychopathie, soit le trouble de la personnalité des psychopathes, lorsqu’on parle d’empathie, ce n’est pas vraiment le cas. L’empathie est la capacité cognitive à comprendre les émotions et les pensées d’autrui. Vous comprenez bien que les psychopathe n’ont aucun problème à ce niveau, bien au contraire. Cependant, ils n’ont pas de sympathie à l’égard d’autrui, ou du moins, de leurs victimes. Attention, tous les psychopathes ne sont pas des tueurs. D’ailleurs, il y a en a peut-être dans votre entourage.
! Fin de la mise au point, merci de votre attention !
Les tueurs en série, souvent diagnostiqués avec des traits psychopathiques ou narcissiques, montrent une incapacité marquée à ressentir de la sympathie à l’égard de leurs victimes. Les recherches en neurosciences, comme celles de Decety et Moriguchi (2007), montrent que les psychopathes présentent une activité réduite dans l’amygdale et le cortex préfrontal ventromédial, des régions impliquées dans le traitement des émotions et de l’empathie.
Ce manque de sympathie, combiné à une suractivation du circuit de la récompense, pourrait créer un cocktail dangereux. Tuer devient alors une expérience purement mécanique, un moyen de satisfaire un besoin sans les freins moraux qui arrêtent la plupart d’entre nous.
« D’accord, mais est-ce qu’ils savent que c’est mal ? Ou ils s’en fichent complètement ? »
Bonne question ! Souvent, ils savent que c’est mal au niveau intellectuel, mais ça ne les touche pas émotionnellement. Et ça nous amène à un autre mécanisme :
La dissociation cognitive et le contrôle des pulsions
La dissociation cognitive, c’est cette capacité à compartimenter ses pensées et ses émotions. Chez les tueurs en série, elle peut leur permettre de mener une double vie : un voisin charmant le jour, un prédateur la nuit. Ce mécanisme, étudié par Bandura (1999) dans sa théorie du désengagement moral, explique comment certaines personnes justifient des actes immoraux. Elles se disent que la victime « méritait » son sort, ou que leurs propres besoins priment sur tout. Bien sûr, il ne s’agit pas de quelque chose de conscient, il s’agit plus d’un mécanisme de protection que l’on retrouve aussi dans la dissonance cognitive (voir l’article).
Un dérèglement dopaminergique peut aggraver cette dissociation. Si le circuit de la récompense est trop focalisé sur la satisfaction immédiate, il peut court-circuiter les régions du cerveau responsables du contrôle des impulsions, comme le cortex préfrontal dorsolatéral. Une étude de Raine (2013) montre que les criminels violents présentent souvent une hypoactivité dans cette région, ce qui les rend moins capables de refréner leurs pulsions.
« Mais alors, c’est juste un problème de cerveau ? »
Ce n’est pas juste le cerveau, Laurent. L’environnement et les expériences de vie entrent aussi en jeu. On va voir ça avec le rôle des traumas.
Le rôle des traumas et de l’environnement
Un dérèglement dopaminergique peut être inné, mais il peut aussi être exacerbé par l’environnement. Les tueurs en série ont souvent des antécédents de traumas infantiles – abus physiques, négligence, ou violence familiale. Ces expériences peuvent modifier la régulation des neurotransmetteurs comme la dopamine ou la sérotonine. Une étude de Teicher et al. (2003) montre que les traumas précoces entraînent des altérations dans le système limbique, qui régule les émotions, et dans le circuit dopaminergique, qui peut devenir hypersensible à certains stimuli.
Un enfant qui grandit dans un environnement chaotique peut apprendre à associer la violence ou le contrôle à une forme de plaisir ou de pouvoir, surtout si son circuit dopaminergique est déjà déséquilibré. Ce n’est pas une excuse, mais une explication possible de la façon dont des facteurs biologiques et environnementaux s’entremêlent.
« Donc, c’est comme si leur cerveau était programmé pour chercher des sensations fortes à cause de leur passé ? »
Oui, on pourrait dire ça. Mais il y a aussi une dimension compulsive.
La dimension compulsive : une addiction au pouvoir ?
Si tuer devient une source de dopamine, alors les tueurs en série pourraient développer une forme d’addiction comportementale. Comme un toxicomane qui cherche sa dose, ils pourraient ressentir un besoin irrépressible de répéter l’acte pour retrouver cette sensation. Les travaux de Griffiths (2005) sur les addictions comportementales montrent que des activités comme le jeu ou le sexe peuvent activer le circuit dopaminergique de manière similaire aux drogues. Tuer, pour certains tueurs en série, pourrait suivre le même schéma : anticipation, acte, satisfaction, puis un vide qui les pousse à recommencer ou à retourner sur les lieux du meurtre.
« Mais alors, pourquoi ils s’arrêtent pas, s’ils savent que c’est risqué ? »
Parce que leur cerveau est piégé dans une boucle. C’est là qu’intervient le rôle du stress et des émotions mal régulées.
Le stress, la frustration et la boucle dopaminergique
Les tueurs en série ne vivent pas dans un état de satisfaction constante. Beaucoup rapportent des périodes de frustration intense, de vide émotionnel ou de stress chronique. Ces états peuvent aggraver un dérèglement dopaminergique, car le stress chronique augmente la sensibilité du circuit de la récompense à des stimuli extrêmes (Piazza & Le Moal, 1996). En clair, quand ils se sentent mal, leur cerveau les pousse à chercher une « solution » rapide – dans leur cas, un acte violent qui leur procure une décharge de dopamine.
Cette recherche de solution rapide est aussi en jeu dans le premier acte d’un tueur en série. Puisque si l’on continue la comparaison avec une addiction, personne ne devient dépendant à la cocaïne sans la consommer. Pour les meurtres, c’est pareil. Nous avons donc au moins deux possibilités qui peuvent être, ou non, simultanées :
🔹Les modèles parentaux ont eu recours à des comportements extrêmement violents devant le tueur lorsqu’il était enfant. On parle alors de conditionnement vicariant (voir l’article sur le psychotraumatisme).
🔹La résistance au stress est extrêmement basse. La réaction face à un facteur de stress sera désorganisée, c’est à dire, impulsive et à l’opposée d’un comportement logiquement cohérent.
En ce qui concerne le deuxième cas, c’est une explication plus que probable dans l’affaire concernant la petite Louise (ici). C’est donc, dans le cas d’un tueur en série, une possible entrée dans une trajectoire meurtrière. Puis le mécanisme s’enclenche.
Ce mécanisme peut créer une boucle : frustration, besoin de dopamine, acte violent, satisfaction temporaire, puis retour de la frustration. C’est un cercle vicieux qui explique pourquoi beaucoup de tueurs en série continuent jusqu’à ce qu’ils soient arrêtés.
« Donc, leur cerveau les pousse à faire ça, mais est-ce qu’on peut dire qu’ils sont « malades » ? »
Dans leur cas, on parle de trouble, mais c’est une vision des choses Laurent. Pour conclure, je t’invite simplement à réfléchir à ton orientation sexuelle. Est-ce que c’est quelque chose que tu as choisi ?
Bref…
Un dérèglement du circuit dopaminergique peut jouer un rôle clé dans les comportements des tueurs en série, en transformant des actes violents en une source de plaisir. Mais ce n’est qu’une pièce du puzzle. Les déficits d’empathie, les traumas, la dissociation cognitive, la gestion du stress et les boucles compulsives s’entremêlent pour créer un profil psychologique complexe.
Bibliographie
- Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3(3), 193–209.
- Blair, R. J. R. (2013). The neurobiology of psychopathic traits in youths. Nature Reviews Neuroscience, 14(11), 786–799.
- Buckholtz, J. W., Treadway, M. T., Cowan, R. L., Woodward, N. D., Li, R., Ansari, M. S., … & Meyer-Lindenberg, A. (2010). Dopaminergic network differences in human impulsivity. Science, 329(5991), 532.
- Decety, J., & Moriguchi, Y. (2007). The empathic brain and its dysfunction in psychiatric populations: Implications for intervention across different clinical conditions. BioPsychoSocial Medicine, 1, 22.
- Griffiths, M. D. (2005). A ‘components’ model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of Substance Use, 10(4), 191–197.
- Piazza, P. V., & Le Moal, M. (1996). Pathophysiological basis of vulnerability to drug abuse: Role of an interaction between stress, glucocorticoids, and dopaminergic neurons. Annual Review of Pharmacology and Toxicology, 36, 359–378.
- Raine, A. (2013). The anatomy of violence: The biological roots of crime. Pantheon Books.
- Teicher, M. H., Andersen, S. L., Polcari, A., Anderson, C. M., Navalta, C. P., & Kim, D. M. (2003). The neurobiological consequences of early stress and childhood maltreatment. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 27(1-2), 33–44.
- Volkow, N. D., Wang, G.-J., Fowler, J. S., Tomasi, D., & Telang, F. (2011). Addiction: Beyond dopamine reward circuitry. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(37), 15037–15042.
FAQ
Un dérèglement dopaminergique explique-t-il tous les crimes des tueurs en série ?
Non, ce n’est qu’un facteur parmi d’autres. L’histoire de vie, l’environnement et et le profil psychologique jouent aussi un rôle clé.
Peut-on soigner un dérèglement dopaminergique chez un tueur en série ?
En théorie, certains traitements (médicaments, thérapies) peuvent réguler la dopamine, mais leur efficacité est limitée face à des comportements enracinés.
Les tueurs en série ressentent-ils du plaisir à tuer ?
Certains oui, via une décharge de dopamine, mais cela dépend de leur profil psychologique.
Pourquoi les tueurs en série continuent-ils malgré les risques ?
Leur circuit dopaminergique peut créer une boucle addictive : frustration, acte, satisfaction temporaire, puis retour à la frustration.
Tous les psychopathes deviennent-ils des tueurs en série ?
Non, la psychopathie est un facteur de risque, mais elle ne mène pas systématiquement à des actes violents. L’environnement comptent énormément aussi.
Marius François – Psychologue clinicien, Psychothérapeute, Hypnose, EMDR – Moulins (03)
Regard d’un psychologue sur les tueurs en série, serial killer
Explication des comportements criminels par un psychologue spécialisé en délinquance et toxicomanie, psychopathologie