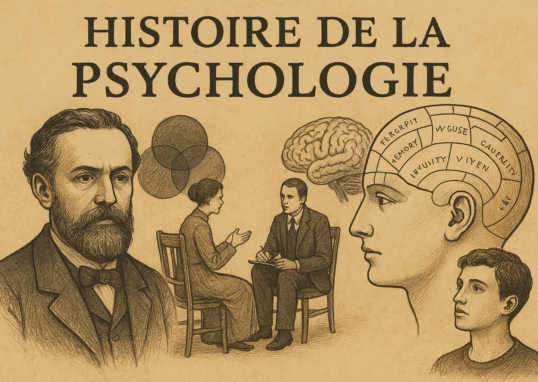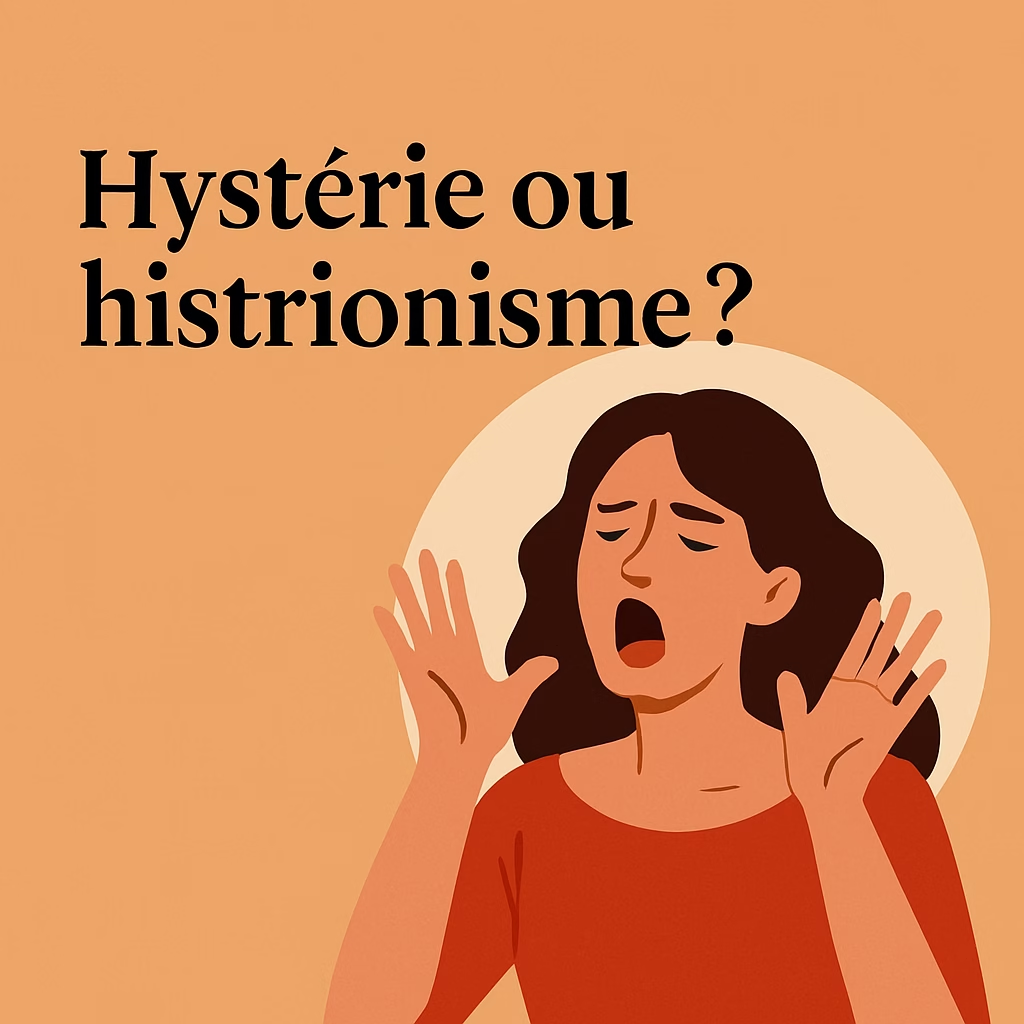
L’hystérie, concept chargé d’histoire, a fasciné et divisé les penseurs, des médecins antiques aux psychologues modernes. Autrefois associée à des manifestations somatiques spectaculaires, elle s’est transformée dans les classifications contemporaines en trouble de la personnalité histrionique (TPH), un diagnostic plus précis mais toujours marqué par des stéréotypes. Quels sont les contours de ce trouble ? Comment a-t-il évolué ? Quels symptômes observe-t-on, et comment les psychologues accompagnent-ils les personnes concernées ?
Hystérie ou histrionisme ?
L’hystérie, devenue trouble de la personnalité histrionique dans les classifications modernes, a une histoire riche, marquée par des visions genrées et des avancées scientifiques.
« C’était pas un diagnostic réservé à la gent féminine ? »
Si, absolument Flo !
Des origines antiques à la psychiatrie moderne
Le terme « hystérie » tire son origine du grec hystera (utérus), reflétant une croyance ancienne selon laquelle ce trouble était causé par des perturbations utérines chez les femmes. Dans l’Égypte ancienne et chez Hippocrate, des symptômes variés comme des convulsions ou des paralysies étaient attribués à un « utérus errant » (Tasca et al., 2012). Cette vision, teintée de misogynie, persiste jusqu’au Moyen Âge, où l’hystérie est parfois confondue avec des possessions démoniaques (Scull, 2009).
Au XIXe siècle, l’hystérie devient un objet central de la psychiatrie. À la Salpêtrière, Jean-Martin Charcot la redéfinit comme un trouble neurologique caractérisé par des symptômes somatiques sans cause organique, comme des paralysies fonctionnelles ou des crises pseudo-épileptiques (Charcot, 1878–1880; Micale, 1995). Ses démonstrations, souvent théâtrales, mettaient en scène des patientes, majoritairement issues de milieux marginalisés, renforçant une image stéréotypée (Showalter, 1997).
« Même si l’expression de cette maladie est théâtrale ou stéréotypé, qu’est-ce que ça change ?! »
Dison que ça soulève un questionnement : est-ce que la personne simule ? Heureusement, les psychologues d’aujourd’hui reconnaissent l’importance de dépasser ces représentations pour une approche plus nuancée.
L’apport de la psychanalyse
Sigmund Freud et Josef Breuer marquent un tournant en conceptualisant l’hystérie comme un trouble psychogène, lié à des conflits inconscients et à des traumatismes refoulés. Leur ouvrage Études sur l’hystérie (Breuer & Freud, 1895/1955) introduit la « cure par la parole », précurseur de la psychanalyse, mettant en lumière le rôle des émotions dans les symptômes (Makari, 2008).
Cette approche influence encore les pratiques des psychologues, qui explorent les racines inconscientes des troubles émotionnels.
« Tu veux dire qu’avant Freud et Breuer, la psychothérapie n’existait pas ? »
Disons qu’ils ont ciblé la psychothérapie et créé la psychanalyse
Vers le trouble de la personnalité histrionique
Au XXe siècle, les classifications modernes redéfinissent l’hystérie. Dans le DSM-II (1968), elle reste présente, mais le DSM-III (1980) la fragmente en troubles somatoformes, troubles dissociatifs et trouble de la personnalité histrionique (TPH) (American Psychiatric Association, 1980). Le DSM-5 (2013) définit le TPH comme un « schéma envahissant de recherche d’attention et d’émotivité excessive », abandonnant le terme « hystérie » pour ses connotations péjoratives (American Psychiatric Association, 2013).
Cette évolution reflète une volonté de dépasser les stéréotypes genrés, un défi que les psychologues intègrent dans leur pratique pour offrir des diagnostics plus justes (Paris, 2012; Novais et al., 2015).
« L’hystérie, c’est juste une recherche d’attention ? C’est pas vraiment une maladie alors ?! »
C’est un peu plus complexe que ça…
Symptômes : de l’hystérie au trouble de la personnalité histrionique
L’hystérie et le TPH (Trouble de la Personnalité Histrionique) se distinguent par leurs manifestations, évoluant des symptômes somatiques spectaculaires à des traits de personnalité complexes, souvent observés dans les consultations des psychologues.
Symptômes historiques de l’hystérie
Historiquement, l’hystérie se caractérisait par une vaste gamme de symptômes physiques et psychologiques sans cause organique. Charcot décrivait des crises convulsives, des paralysies fonctionnelles, des troubles sensoriels (p. ex., anesthésies) et des comportements théâtraux (Charcot, 1878–1880; Micale, 1995).
Freud soulignait les symptômes de conversion, comme une cécité ou une aphonie psychogène, où des conflits psychiques s’exprimaient somatiquement (Breuer & Freud, 1895). Ces symptômes étaient influencés par le contexte socio-culturel, notamment les attentes genrées (Showalter, 1997).
Symptômes du trouble de la personnalité histrionique
Le TPH, tel que défini dans le DSM-5, se manifeste par des traits de personnalité persistants, observables dès l’adolescence ou le début de l’âge adulte (American Psychiatric Association, 2013). Les critères incluent :
🔹Recherche excessive d’attention : Besoin constant d’être au centre de l’attention, souvent par des comportements séducteurs ou provocateurs (Bornstein, 1998).
🔹Émotivité excessive : Émotions intenses, changeantes, parfois perçues comme superficielles (Linehan, 1993).
🔹Théâtralisation : Expression exagérée des émotions, pouvant sembler manipulatrice (Millon, 2011).
🔹Suggestibilité : Forte influence par les autres ou les circonstances (Widiger & Samuel, 2005).
🔹Perception biaisée des relations : Croyance en des relations plus intimes qu’elles ne le sont réellement (Paris, 2012).
Sous cette expressivité se cache souvent une insécurité affective profonde, liée à des expériences précoces où l’attention conditionnait la valeur personnelle (Sulz, 2010). Ces traits, s’ils causent une souffrance ou une altération du fonctionnement, justifient un diagnostic selon certains auteurs (Skodol et al., 2014). Les psychologues observent souvent ces comportements dans un contexte de relations interpersonnelles complexes.
« Il suffirait que les personnalités histrioniques aient des amis sains et véritables »
Ce serait super, mais pas suffisant !
Prise en charge : une approche empathique et multidisciplinaire
La prise en charge de l’hystérie historique et du TPH moderne a considérablement évolué, passant de traitements autoritaires à des approches psychothérapeutiques centrées sur le patient.
Approches historiques
Au XIXe siècle, l’hystérie était traitée par des méthodes variées, souvent invasives : hypnose (Charcot, 1878–1880), hystérectomie (Tasca & al., 2012), électrochoc (Shorter & Healy,2007) et d’autres thérapies physiques telles que des bains ou des massages pelviens. C’est d’ailleurs dans ce contexte que le vibromasseur électromécanique a été inventé (Maines, 2009).
« Qu… Qu… Quoi ?!?! «
Oui, c’est bien ça…
Au 19ème siècle, en considérant que l’utérus était la source du problème, on pensait que pour soigner ce trouble, il fallait agir sur lui… L’hystérectomie consistait en une ablation du clitoris ou de l’utérus. D’autres se sont tournés vers le massage pelvien afin de déclencher un « paroxysme hystérique », plus communément appelé « orgasme »…
« C’est assez incroyable… »
Heureusement, aujourd’hui, on propose des choses acceptables.
Prise en charge moderne du Trouble de la Personnalité Histrionique
Aujourd’hui, la psychothérapie est au cœur de la prise en charge du trouble de la personnalité histrionique, avec des approches adaptées aux besoins des patients :
🔹Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) :
La TCC aide à modifier les schémas de pensée dysfonctionnels, comme la recherche excessive d’attention, et à développer des stratégies d’adaptation. Beck et al. (2015) démontrent son efficacité pour réduire l’impulsivité et l’émotivité excessive.
🔹Thérapie psychodynamique :
En explorant les conflits inconscients et les expériences précoces (p. ex., attachement insécure), cette approche améliore la régulation émotionnelle (Horowitz, 2014). Les psychologues peuvent utiliser cette méthode pour travailler sur les racines affectives du trouble.
🔹Thérapie de groupe :
Elle favorise des relations authentiques et réduit la dépendance à l’approbation des autres (Yalom & Leszcz, 2005).
🔹Thérapie dialectique-comportementale (TDC) :
Adaptée pour les cas de dysrégulation émotionnelle sévère, elle aide à moduler les émotions et renforcer l’estime de soi (Linehan, 1993).
L’alliance thérapeutique est cruciale : face à des patients parfois envahissants ou charismatiques, les psychologues maintiennent un cadre sécure, évitant le rejet ou l’interprétation hâtive. La médication est rarement indiquée, sauf pour traiter des comorbidités comme l’anxiété ou la dépression (Zimmerman et al., 2010). Une approche multidisciplinaire, associant psychologues, psychiatres et travailleurs sociaux, est souvent nécessaire pour répondre aux besoins complexes des patients (Paris, 2012).
« C’est pas tout d’avoir des professionnels pour accompagner l’histrionisme. Qu’en est-il de l’entourage sociale ? »
Excellente question Flo ! Au-delà des aspects cliniques, le Trouble de la Personnalité Histrionique soulève des enjeux sociaux et culturels.
Enjeux sociaux : stigmates, genre et représentations
Le Trouble de la Personnalité Histrionique est profondément marqué par des enjeux sociaux, que ce soit dans l’entourage ou même au sein des équipes soignantes qui les accompagnent.
Stigmatisation et biais genrés
Historiquement associée aux femmes, l’hystérie a véhiculé des stéréotypes sexistes, renforcés par les descriptions de Charcot et Freud (Showalter, 1997). Le TPH, bien que mieux défini, reste influencé par ces héritages : il est diagnostiqué plus fréquemment chez les femmes, possiblement en raison de biais culturels (Skodol et al., 2014; Widiger & Samuel, 2005).
Les psychologues restent attentifs à ces biais, veillant à ne pas pathologiser des comportements expressifs normatifs, notamment chez les femmes (Bornstein, 1998). Pour plus d’informations à ce sujet, voir l’article : Pourquoi faut-il arrêter de diagnostiquer en psychiatrie ?
Impact social et inclusion
Les personnes atteintes de TPH sont souvent perçues comme « théâtrales » ou « manipulatrices », ce qui peut entraîner une marginalisation et des difficultés relationnelles (Millon, 2011).
Les psychologues jouent un rôle clé dans la sensibilisation du public et des professionnels pour réduire la stigmatisation et promouvoir une prise en charge empathique. Les critiques féministes soulignent que la société valorise souvent l’invisibilité émotionnelle, pathologisant ceux qui s’expriment vivement (Tasca et al., 2012). Restaurer un lien à soi plus stable, comme le proposent les psychologues, passe par une compréhension des fonctions adaptatives de ces comportements.
« Donc une psychothérapie ne suffit par pour soigner ce trouble. Il faut aussi un accompagnement social et un cadre sécure. »
Tout en gardant à l’esprit que chaque trouble est différent en fonction des individus, donc chaque thérapie aussi…
En bref…
De l’hystérie antique au trouble de la personnalité histrionique, l’histoire de ce concept reflète l’évolution de notre regard sur l’émotion, le genre et le corps. Les psychologues adoptent une approche empathique et scientifique pour accompagner les personnes concernées, déconstruisant les stéréotypes et favorisant l’inclusion. Loin des clichés, le TPH interroge nos normes : qu’est-ce qu’être trop expressif, trop visible ? En explorant les racines psychiques et sociales de ce trouble, les psychologues aident leurs patients à trouver un équilibre entre authenticité et stabilité émotionnelle, tout en plaidant pour une société plus compréhensive. Cette démarche, ancrée dans la science et l’humanisme, nous invite à repenser ce que signifie être soi dans un monde qui juge souvent l’excès d’émotion.
Bibliographie
- American Psychiatric Association. (1968). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (2nd ed.). American Psychiatric Publishing.
- American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd ed.). American Psychiatric Publishing.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Bakkevig, J. F., & Karterud, S. (2010). Is the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition, histrionic personality disorder category a valid construct? Comprehensive Psychiatry, 51(3), 287–293.
- Beck, A. T., Davis, D. D., & Freeman, A. (2015). Cognitive therapy of personality disorders (3rd ed.). Guilford Press.
- Bornstein, R. F. (1998). Reconceptualizing personality disorder categories: Normal, abnormal, and internalizing–externalizing dimensions. Journal of Personality Disorders, 12(4), 323–337.
- Breuer, J., & Freud, S. (1955). Studies on hysteria. In J. Strachey (Ed. & Trans.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 2, pp. 1–335). Hogarth Press. (Original work published 1895)
- Charcot, J.-M. (1878–1880). Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpêtrière (Vols. 1–3). Bureaux du Progrès Médical.
- Horowitz, M. J. (2014). Identity and the new psychoanalytic explorations of self-organization. Routledge.
- Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. Guilford Press.
- Maines, R. P. (1999). The technology of orgasm: “Hysteria,” the vibrator, and women’s sexual satisfaction. Johns Hopkins University Press.
- Makari, G Ascendancy Press. (2008). Revolution in mind: The creation of psychoanalysis. HarperCollins.
- Micale, M. S. (1995). Approaching hysteria: Disease and its interpretations. Princeton University Press.
- Millon, T. (2011). Disorders of personality: Introducing a DSM/ICD spectrum from normal to abnormal (3rd ed.). Wiley.
- Novais, F., Araújo, A., & Godinho, P. (2015). Historical roots of histrionic personality disorder. Frontiers in Psychology, 6, Article 1463.
- Paris, J. (2012). The rise and fall of personality disorders: A historical perspective. Journal of Personality Disorders, 26(1), 1–10.
- Scull, A. (2009). Hysteria: The biography. Oxford University Press.
- Shorter, E., & Healy, D. (2007). Shock therapy: A history of electroconvulsive treatment in mental illness. Rutgers University Press.
- Showalter, E. (1997). Hystories: Hysterical epidemics and modern media. Columbia University Press.
- Skodol, A. E., Bender, D. S., & Morey, L. C. (2014). Personality disorder types proposed for DSM-5. Journal of Personality Disorders, 28(1), 1–23.
- Sulz, S. K. D. (2010). Histrionic personality disorder. Der Nervenarzt, 81(7), 879–887.
- Tasca, C., Rapetti, M., Carta, M. G., & Fadda, B. (2012). Women and hysteria in the history of mental health. Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, 8, 110–119.
- Widiger, T. A., & Samuel, D. B. (2005). Diagnostic categories or dimensions? A question for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders—Fifth Edition. Journal of Abnormal Psychology, 114(4), 494–504.
- Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2005). The theory and practice of group psychotherapy (5th ed.). Basic Books.
- Zimmerman, M., Chelminski, I., & Young, D. (2010). Prevalence and diagnostic correlates of personality disorders in a community sample. The Journal of Clinical Psychiatry, 71(3), 277–284.
FAQ
1. Qu’est-ce qui distingue l’hystérie ancienne du trouble histrionique actuel ?
L’hystérie ancienne incluait des symptômes somatiques spectaculaires (convulsions, paralysies) sans cause organique. Le TPH est une organisation de la personnalité marquée par une recherche excessive d’attention et une affectivité superficielle (American Psychiatric Association, 2013).
2. Le trouble histrionique touche-t-il surtout les femmes ?
Historiquement, oui, mais les études modernes montrent une répartition plus équilibrée. Les stéréotypes genrés influencent encore les diagnostics (Widiger & Samuel, 2005).
3. Peut-on guérir du trouble de la personnalité histrionique ?
Le TPH est chronique, mais une psychothérapie adaptée, comme la TCC ou la thérapie psychodynamique, peut réduire les symptômes et améliorer la qualité de vie (Beck et al., 2015). Les psychologues à Moulins proposent des approches personnalisées pour accompagner ces changements.
4. Comment différencier un comportement histrionique d’une personnalité expressive ?
Un comportement histrionique est envahissant, source de souffrance ou de dysfonctionnement, et répond à des critères diagnostiques précis, contrairement à une personnalité expressive normative (Millon, 2011).
5. Comment aider une personne avec un TPH à Moulins ?
Par une écoute empathique, des limites claires et une orientation vers un psychologue à Moulins pour une psychothérapie adaptée, visant à renforcer l’estime de soi et l’authenticité émotionnelle.
Marius François – Psychologue clinicien, Psychothérapeute, Hypnose, EMDR – Moulins (03)