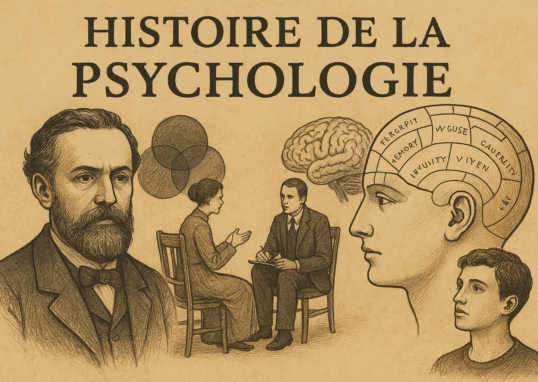Se prendre d’amitié ou même d’amour pour la personne qui vous prend en otage, ça paraît surréaliste et pourtant… Ce phénomène, connu sous le nom de syndrome de Stockholm, défie l’intuition et fascine autant qu’il intrigue. Popularisé par les récits médiatiques, il soulève une question essentielle : est-ce une réalité validée par la science ou un mythe amplifié par la culture populaire ? En tant que psychologue à Moulins, je vous invite à plonger dans la littérature scientifique pour démêler le vrai du faux, explorer les mécanismes psychologiques et biologiques sous-jacents, et découvrir comment un accompagnement thérapeutique peut éclairer ces dynamiques complexes.
« Pfffff, j’y crois pas une minute ! »
Et pourtant Monica, c’est bien ce qu’il s’est passé en 1973
Les origines du syndrome de Stockholm : une naissance controversée
Le terme syndrome de Stockholm voit le jour en 1973, lors d’un braquage de banque à Stockholm, en Suède. Pendant six jours, les otages développent une relation inattendue avec leurs ravisseurs, allant jusqu’à refuser de témoigner contre eux après leur libération.
Le criminologue Nils Bejerot (1978), dans Acta Psychiatrica Scandinavica, décrit ce comportement comme une réponse adaptative à un stress extrême. Cependant, l’absence de critères diagnostiques précis suscite immédiatement des débats.
Ni le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5, 2013) ni la Classification internationale des maladies (CIM-10) ne reconnaissent ce syndrome comme un trouble psychologique officiel, alimentant le scepticisme.
« Donc le criminologue a improvisé une explication… Bien joué Nils ! »
Pas forcément, c’est pas évident de prouver l’existence d’un tel phénomène.
Que dit la science sur ce phénomène ?
La littérature scientifique reste prudente. Une revue systématique de Namnyak et al. (2008), publiée dans The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, conclut que le syndrome de Stockholm est rare et mal défini, avec seulement une dizaine d’études valides, principalement des études de cas. Un rapport du FBI (1999) estime que ce phénomène concerne 5 à 8 % des otages, soulignant sa rareté.
Les cas médiatisés, comme celui de Patricia Hearst en 1974, où la victime a rejoint ses ravisseurs, sont souvent cités, mais manquent de validation empirique rigoureuse. Les chercheurs identifient plusieurs mécanismes psychologiques pour expliquer ce phénomène :
🔹L’identification à l’agresseur : Décrite par Freud (1940), cette dynamique suggère qu’une personne peut adopter les perspectives de son agresseur pour réduire l’anxiété face à une menace.
🔹Le coping adaptatif : Alexander et al. (2007), montrent que les victimes peuvent développer une empathie pour leur ravisseur comme stratégie de survie, proche de la dissociation traumatique.
🔹La dissonance cognitive : Festinger (1957), explique que les victimes peuvent rationaliser leur situation en percevant leur agresseur comme bienveillant pour réduire le conflit interne.
🔹L’attachement traumatique : Cantor et Price (2007), proposent que le syndrome s’apparente à un lien traumatique, où la victime développe un attachement pathologique pour se sentir en sécurité.
🔹Liens affectifs paradoxaux : Kouassi N’ZI et Bissouma (2024), décrivent des victimes d’agressions en Côte d’Ivoire développant une dépendance émotionnelle envers leurs agresseurs, souvent par gratitude pour des actes perçus comme “bienveillants”.
Une méta-analyse de Thompson et Carter (2020), dans Frontiers in Psychology, souligne le manque de standardisation des critères diagnostiques, rendant difficile la distinction entre un syndrome spécifique et des réponses psychologiques plus générales.
« En clair, on peine a définir ce phénomène comme un syndrome ou comme une réaction psychologique normale ? »
Exactement, même si on connait grossièrement le processus.
Une perspective neuroscientifique et évolutionniste
Des recherches récentes enrichissent notre compréhension. Awad et al. (2019), dans Neuroscience & Biobehavioral Reviews, explorent les bases neurologiques des comportements d’attachement en situation de stress extrême. L’activation de l’amygdale et du cortex préfrontal, couplée à une libération d’ocytocine (hormone de l’attachement), pourrait expliquer l’empathie paradoxale envers un agresseur. De plus, Harnischmacher et Müther (1987), proposent une perspective bio-évolutionniste : ce “bonding” serait un mécanisme d’apaisement ancré dans le cerveau reptilien, observé chez les primates pour assurer la survie face à une menace.
« Donc ce phénomène apparaîtrait dans de multiples situations, pourvue qu’elles soient stressantes ? »
Oui, une prise d’otage, une agression, un examen…
Contextes d’apparition : au-delà des prises d’otages
Le syndrome de Stockholm ne se limite pas aux prises d’otages. Des études récentes identifient des dynamiques similaires dans divers contextes :
🔹Violence conjugale : Alshwaiheen et al. (2025), dans Cureus, décrivent un cas où une femme victime de violence conjugale présente à la fois un syndrome de Stockholm et un trouble de stress post-traumatique (TSPT). Les auteurs décrivent comment la victime, confrontée à des abus répétés, forme un attachement paradoxal envers son agresseur, perçu comme une source de protection face à des menaces perçues comme plus grandes. Ce phénomène s’explique par des mécanismes psychologiques tels que la dépendance émotionnelle, la peur chronique et la distorsion cognitive, où la victime rationalise les actes violents pour réduire l’anxiété.
🔹Abus sexuels et trafic sexuel : Effiong et al. (2022), dans Journal of Social and Personal Relationships, notent que l’attachement traumatique est souvent utilisé pour maintenir la soumission des victimes. Leur analyse révèle que les agresseurs exploitent souvent des stratégies psychologiques, comme l’alternance entre violence et actes de pseudo-affection, pour induire un lien affectif chez les victimes. Cet attachement traumatique, proche du syndrome de Stockholm, maintient la soumission des victimes en renforçant leur dépendance émotionnelle envers l’agresseur. Les auteurs soulignent que ce mécanisme est particulièrement marqué dans les situations de trafic sexuel, où l’isolement social et la manipulation psychologique limitent les options de fuite.
« C’est aussi ce que fait la police, le bon flic et le mauvais flic »
C’est exactement ça !
🔹Agressions : Kouassi N’ZI et Bissouma (2024) rapportent des liens affectifs paradoxaux chez les victimes d’assaut en Côte d’Ivoire. Publiée dans une revue spécialisée, leur étude montre que ces liens émergent souvent dans des contextes de violence répétée ou de proximité prolongée avec l’agresseur, où la victime perçoit des gestes isolés de clémence comme des preuves d’humanité.
« Alors, syndrome ou mythe médiatique ? »
L’entre deux Monica !
Le syndrome de Stockholm reste controversé. López et al. (2021), dans European Journal of Psychology Applied to Legal Context, critiquent son utilisation dans les contextes judiciaires, arguant que son manque de critères clairs peut mener à des interprétations erronées, notamment dans les cas de violences conjugales ou institutionnelles. Namnyak et al. (2008) dénoncent une étiquette médiatique qui masque les dynamiques de pouvoir et les résistances des victimes. Malgré ces critiques, le concept reste utile pour décrire des mécanismes adaptatifs dans des situations extrêmes.
En bref…
Le syndrome de Stockholm, bien qu’il ne soit pas un trouble officiel, soulève des questions fascinantes sur la complexité des réactions humaines face au trauma. En s’appuyant sur la littérature scientifique, nous découvrons qu’il s’agit d’un phénomène rare, ancré dans des mécanismes psychologiques (identification à l’agresseur, dissonance cognitive, attachement traumatique) et biologiques (activation de l’amygdale, ocytocine). À Moulins, en tant que psychologue, j’accompagne ceux qui souhaitent explorer ces dynamiques ou comprendre leurs propres expériences. Si ce sujet vous interpelle ou si vous cherchez à mieux naviguer vos émotions, contactez mon cabinet pour une consultation personnalisée.
Prenez rendez-vous avec un psychologue à Moulins pour explorer vos émotions et surmonter les défis psychologiques avec un accompagnement professionnel.
FAQ : Le syndrome de Stockholm démystifié
Le syndrome de Stockholm est-il un trouble psychologique reconnu ?
Non, il n’est pas répertorié dans le DSM-5 ou la CIM-10. Il est considéré comme un phénomène psychologique rare, lié à des mécanismes comme l’identification à l’agresseur ou l’attachement traumatique.
Quelle est la fréquence du syndrome de Stockholm ?
Selon un rapport du FBI (1999), il concerne 5 à 8 % des otages, mais reste rare et souvent amplifié par les médias.
Le syndrome de Stockholm est-il lié au PTSD ?
Les études montrent une relation complexe : concomitance, séquentialité ou indépendance, selon les cas.
Peut-on mesurer scientifiquement le syndrome de Stockholm ?
Oui, via des outils comme la Stockholm Syndrome Scale (Graham et al., 1995), validée pour évaluer la dépendance émotionnelle et les distorsions cognitives.
Comment un psychologue à Moulins peut-il aider dans le syndrome de Stockholm ?
Un psychologue à Moulins peut accompagner via des approches comme les TCC, l’EMDR ou toute autre thérapie permettant de travailler sur les traumas, les attachements toxiques et la reconstruction cognitive. Contactez mon cabinet pour plus d’information.
Peut-on observer ces dynamiques dans des relations toxiques ?
Oui, des mécanismes comme l’attachement traumatique ou la dissonance cognitive peuvent apparaître dans des relations toxiques, même hors contextes extrêmes.
Bibliographie :
- Alshwaiheen, N., Saleh, D., & Alani, W. (2025). A case of post-traumatic stress disorder (PTSD) complicated by Stockholm syndrome: A unique psychiatric phenomenon in the context of intimate partner violence. Cureus, 17(4), e82307.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Awad, J., Rasia-Filho, A. A., & Spruyt, K. (2019). Neurobiological mechanisms of attachment in extreme stress: Insights from Stockholm syndrome. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 105, 88-98.
- Bejerot, N. (1978). The six day war in Stockholm. Acta Psychiatrica Scandinavica, 57(Suppl. 270), 12-20.
- Cantor, C., & Price, J. (2007). Traumatic entrapment, appeasement and complex post-traumatic stress disorder: Evolutionary perspectives of hostage reactions, domestic abuse and the Stockholm syndrome. Clinical Psychology Review, 27(5), 573-590.
- Effiong, J. E., Ibeagha, P. N., & Iorfa, S. K. (2022). Traumatic bonding in victims of intimate partner violence is intensified via empathy. Journal of Social and Personal Relationships, 39(7), 2034-2055.
- Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.Freud, S. (1940). An outline of psycho-analysis. International Journal of Psycho-Analysis, 21, 27-84.
- Graham, D. L. R., Rawlings, E. I., & Rigsby, R. K. (1995). Loving to survive: Sexual terror, men’s violence, and women’s lives. Journal of Interpersonal Violence, 10(4), 413-434.
- Harnischmacher, R., & Müther, J. (1987). The Stockholm syndrome on the psychological reaction of hostages and hostage-takers. Archiv für Kriminologie, 180(1-2), 1-12.
- Kouassi N’ZI, A. M., & Bissouma, A.-C. (2024). Cognitive distortions and coping strategies: Stockholm syndrome among victims of assault in Ivory Coast. European Journal of Humanities and Social Sciences, 4(2), 45-59.
- López, R., García, M., & Fernández, P. (2021). Stockholm syndrome in legal contexts: A critical review. European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 13(2), 67-75.
- Namnyak, M., Tufton, N., Szekely, R., Toal, M., Worboys, S., & Sampson, E. L. (2008). ‘Stockholm syndrome’: Psychiatric diagnosis or urban myth? The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 19(3), 328-343.
- Rozenblum, J. (2023, February 10). Syndrome de Stockholm : quand la victime s’éprend de son ravisseur. Le Figaro. https://sante.lefigaro.fr
- Thompson, L., & Carter, R. (2020). Revisiting Stockholm syndrome: A meta-analysis of psychological responses to captivity. Frontiers in Psychology, 11, 567-578.
En tant que psychologue à Moulins, comprendre ces mécanismes permet de proposer un accompagnement adapté :
- Thérapies cognitivo-comportementales (TCC) : Pour déconstruire les distorsions cognitives, comme la justification de l’agresseur.
- EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) : Pour traiter les traumas sous-jacents.
- Thérapies trauma-informed : Pour renforcer la sécurité affective et le réseau social.
- Utilisation d’échelles validées : Comme la Stockholm Syndrome Scale, pour évaluer les liens paradoxaux.
Que vous cherchiez à surmonter un trauma, à comprendre une relation toxique ou à explorer vos réactions, un suivi psychologique à Moulins offre un espace sécurisé pour avancer. Pour toute question, n’hésitez pas à appeler un psychologue sur Moulins ou directement prendre RDV avec un psychologue. Avoir un avis psychologique, même ponctuel peut aider. Un rdv avec un psychologue ne débouche pas forcément sur une prise en charge avec des rdv réguliers. Certaines fois, un seul et unique rdv avec un psychologue suffit. En fonction de la problématique, le psychologue vous donnera un avis sur la nécessité d’entamer un suivi. Certaines personnes n’ont pas besoin de consulter un psychologue. D’autres personnes auront besoin ponctuellement de consulter un psychologue.
Marius François – Psychologue clinicien, Psychothérapeute, Hypnose, EMDR – Moulins (03)