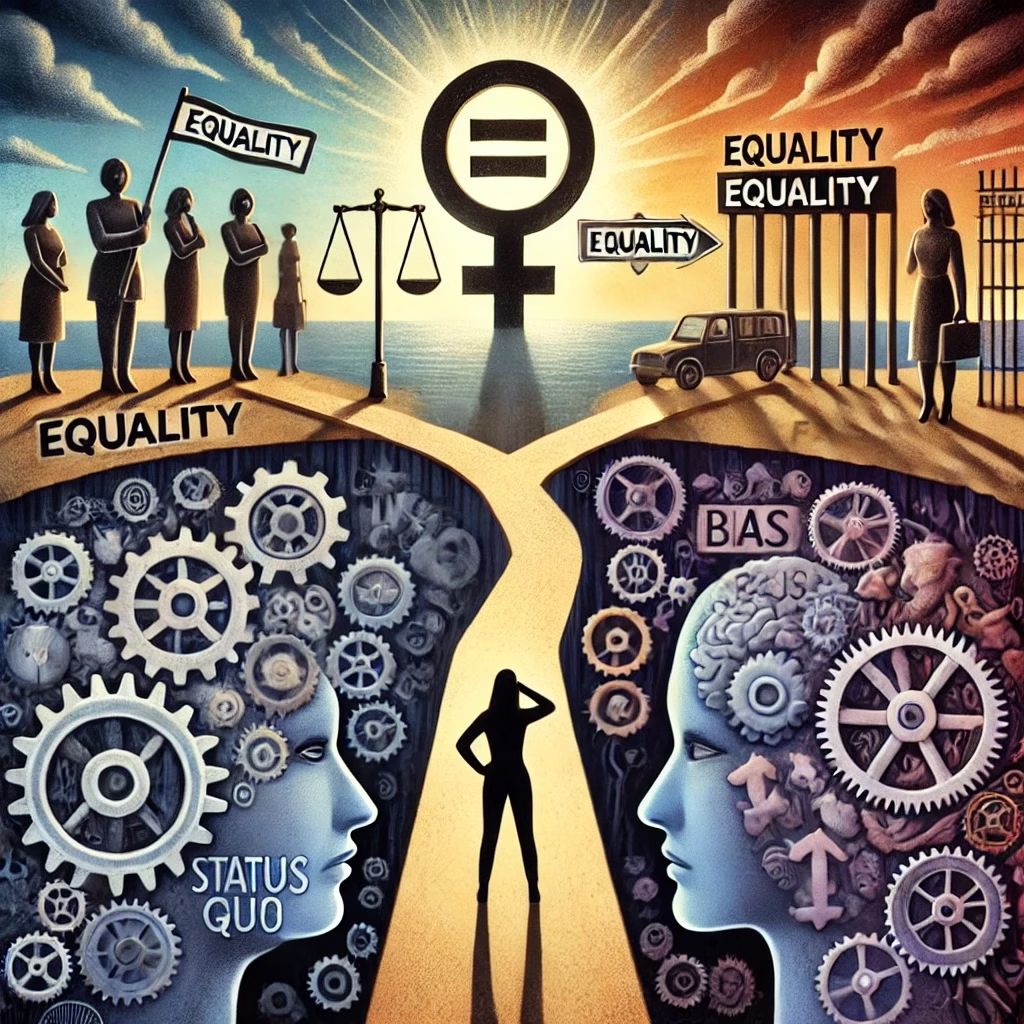
Pourquoi le féminisme ne parvient pas à atteindre ses objectifs ? Les ambitions du féminisme – égalité, justice, déconstruction des hiérarchies… – résonnent comme un appel puissant à transformer les sociétés. Pourtant, les obstacles persistent, les progrès s’essoufflent, et les idéaux semblent parfois flotter hors de portée. Plutôt que de chercher les coupables dans les structures patriarcales ou les résistances ouvertes, une exploration des mécanismes psychologiques offre un autre éclairage. Car, au fond, les limites du féminisme ne seraient-elles pas inscrites dans les rouages mêmes de la pensée humaine ?
Le poids des biais cognitifs et des dynamiques de groupe
Les biais cognitifs façonnent la perception du monde bien plus qu’on ne l’admet généralement. Le biais de statu quo, étudié par Samuelson et Zeckhauser (1988), illustre cette tendance à préférer ce qui existe déjà, même face à des alternatives objectivement meilleures. Les rôles genrés, ancrés dans des siècles de répétition, bénéficient de cette inertie mentale. Cette tendance se retrouve chez tout le monde, par nature et se traduit parfaitement par l’expression « c’était mieux avant ». Une étude de Nosek et al. (2007) sur le test d’association implicite révèle que les associations homme-pouvoir et femme-soin restent prédominantes, même chez ceux qui se disent égalitaires. Ces schémas ne cèdent pas facilement, car ils offrent une stabilité cognitive.
» Donc, les gens résistent au féminisme parce qu’ils aiment le confort des vieilles idées ? »
– C’est bien ça Camille, mais la vraie question est :
Pourquoi certains s’y accrochent plus que d’autres ?
Les dynamiques de groupe apportent un début de réponse. La théorie de l’identité sociale de Tajfel et Turner (1979) montre que l’appartenance à un groupe – ici, homme ou femme – renforce l’estime de soi par opposition aux autres groupe. Le féminisme, en brouillant ces lignes, donc l’appartenance à un groupe précis, déclenche une résistance instinctive. Les travaux de Sidanius et Pratto (1999) sur la dominance sociale ajoutent une nuance : certains individus, souvent hommes mais pas exclusivement, valorisent les hiérarchies comme un moyen de maintenir leur statut. Cette résistance n’est pas toujours consciente ; elle est viscérale, ancrée dans le besoin de se définir.
« Oui, donc il faut simplement faire prendre conscience »
– On est bien d’accord, le meilleur moyen de lutter contre un biais cognitif, c’est de le montrer du doigt, mais pas n’importe comment.
La culpabilisation, un levier inefficace
Les discours féministes s’appuient souvent sur la culpabilisation – des privilèges masculins, des silences complices – pour provoquer un sursaut. Mais cette stratégie trébuche sur des réalités psychologiques (voir l’article ici). Les recherches de Baumeister et al. (1994) sur les émotions négatives montrent que la culpabilité, bien qu’elle puisse motiver à court terme, engendre aussi rejet et hostilité quand elle devient chronique. Une campagne accusant les hommes de « toxicité » ou les femmes de « soumission intériorisée » risque de fermer plus de portes qu’elle n’en ouvre.
« D’accord, mais alors, quelles pistes faudrait-il explorer ? »
Eviter la confrontation :
Les études de Pennebaker (1997) sur l’expression émotionnelle suggèrent que les messages centrés sur l’empathie ou les bénéfices mutuels touchent davantage. Quand une personne se sent attaquée, elle active ce que Gilbert (1998) nomme le « système de défense sociale » : elle se replie ou contre-attaque. Les données de Monteith et al. (2002) confirment que les confrontations directes aux biais sexistes, si elles ne sont pas nuancées, réduisent l’adhésion, surtout chez ceux qui ne se perçoivent pas comme partie du problème. Ce qui pourrait aboutir à de l’agressivité provenant même des personnes qui défendent la bonne cause.
L’idéalisation de l’égalité, un piège cognitif ?
L’égalité absolue, où le genre n’aurait plus aucune incidence, séduit par sa pureté. Mais cette vision se heurte à des limites cognitives et évolutionnistes. Les travaux de Tooby et Cosmides (1992) sur la psychologie évolutionniste soulignent que l’esprit humain a évolué pour détecter les différences – de sexe, de statut, de rôle – comme des indices de survie (voir l’article ici). Une étude de Ridgeway (2011) sur les attentes de statut montre que les interactions quotidiennes renforcent ces distinctions, même dans des contextes égalitaires. L’égalité totale devient alors un idéal abstrait, difficile à ancrer dans une réalité où les différences sont visibles.
« Donc, l’égalité pure est impossible à cause de notre cerveau ? Ça veut dire qu’on abandonne ? »
– Non, ça veut juste dire qu’il faut prendre conscience de « l’autre »
Les recherches de Deci et Ryan (2000) sur la théorie de l’autodétermination suggèrent une piste : les individus acceptent mieux les changements qui respectent leurs besoins fondamentaux – autonomie, compétence, connexion (sociale). Plutôt que d’effacer les différences, le féminisme pourrait viser une équité qui les intègre sans les figer. Car abolir toute distinction demande un effort cognitif que peu sont prêts à fournir.
« Donc la solution passerait par la coopération ? »
– Oui Camille, c’est très envisageable !
Face à ces blocages, une approche alternative émerge. La théorie de la coopération de Deutsch (1949) montre que des groupes opposés progressent quand ils partagent un objectif commun. Les travaux de Sherif (1956) sur l’expérience de Robbers Cave confirment que la rivalité s’efface devant une cause partagée. Appliqué au féminisme, cela impliquerait d’inviter hommes et femmes à redéfinir les rôles ensemble, plutôt que de les confronter.
« Coopérer, ça sonne bien, mais concrètement, comment faire ? »
Les études de Pettigrew et Tropp (2006) sur le contact intergroupe offrent une réponse : des interactions positives et égalitaires réduisent les préjugés. Un féminisme qui mettrait l’accent sur des bénéfices mutuels – une société moins rigide pour tous – pourrait rallier plus largement. Car, au bout du compte, transformer les mentalités exige de les accompagner, pas de les brusquer, tout en respectant leurs besoins.
Bref…
Le féminisme ne parvient pas à atteindre ses objectifs pour plusieurs raisons. Les obstacles qui se dressent ne sont pas insurmontables, mais ils demandent à être regardés en face. Les biais cognitifs, les dynamiques de groupe, l’inefficacité de la culpabilisation, l’idéalisation d’une égalité pure et le potentiel inexploité de la coopération dessinent un tableau complexe. Loin de condamner la lutte, cette analyse invite à repenser ses outils. Car transformer les sociétés, c’est d’abord comprendre les esprits qui les composent – leurs réticences, leurs besoins, leurs possibles.
Les recherches montrent que les changements profonds naissent d’une rencontre entre l’idéal et le réel. Pettigrew et Tropp (2006) rappellent que le contact et la coopération désarment les préjugés ; Deci et Ryan (2000) insistent sur l’importance de respecter les motivations humaines. Le féminisme pourrait gagner à s’adapter : moins marteler des vérités absolues, plus tisser des ponts. Et si, finalement, son succès passait par une révolution douce – celle qui rallie plutôt qu’elle ne divise ?
Bibliographie
- Baumeister, R. F., Stillwell, A. M., & Heatherton, T. F. (1994). « Guilt: An Interpersonal Approach ». Psychological Bulletin, 115(2), 243-267.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). « The ‘What’ and ‘Why’ of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior ». Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.
- Deutsch, M. (1949). « A Theory of Cooperation and Competition ». Human Relations, 2(2), 129-152.
- Gilbert, P. (1998). « Evolutionary Psychopathology: Why Isn’t the Mind Designed Better Than It Is? ». British Journal of Medical Psychology, 71(4), 353-373.
- Monteith, M. J., Ashburn-Nardo, L., Voils, C. I., & Czopp, A. M. (2002). « Putting the Brakes on Prejudice: On the Development and Operation of Cues for Control ». Journal of Personality and Social Psychology, 83(5), 1029-1050.
- Nosek, B. A., Banaji, M. R., & Greenwald, A. G. (2007). « Gender Stereotypes and Implicit Bias: The Implicit Association Test ». Journal of Personality and Social Psychology, 92(5), 822-834.
- Pennebaker, J. W. (1997). « Writing About Emotional Experiences as a Therapeutic Process ». Psychological Science, 8(3), 162-166.
- Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). « A Meta-Analytic Test of Intergroup Contact Theory ». Journal of Personality and Social Psychology, 90(5), 751-783.
- Ridgeway, C. L. (2011). Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World. Oxford University Press.
- Samuelson, W., & Zeckhauser, R. (1988). « Status Quo Bias in Decision Making ». Journal of Risk and Uncertainty, 1(1), 7-59.
- Sherif, M. (1956). « Experiments in Group Conflict ». Scientific American, 195(5), 54-58.
- Sidanius, J., & Pratto, F. (1999). Social Dominance: An Intergroup Theory of Social Hierarchy and Oppression. Cambridge University Press.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). « An Integrative Theory of Intergroup Conflict ». In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The Social Psychology of Intergroup Relations (pp. 33-47). Brooks/Cole.
- Tooby, J., & Cosmides, L. (1992). « The Psychological Foundations of Culture ». In J. H. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), The Adapted Mind (pp. 19-136). Oxford University Press.
FAQ
1. Le féminisme est-il inefficace à cause du patriarcat ou des résistances sociales ?
Le patriarcat joue un rôle important, mais cet article propose une autre lecture : les obstacles psychologiques – biais cognitifs, dynamiques de groupe, peur de perdre son statut – pèsent lourdement dans la résistance au changement, parfois même de façon inconsciente.
2. Pourquoi certaines personnes résistent plus que d’autres au féminisme ?
Cela peut s’expliquer par la théorie de la dominance sociale ou l’identité de groupe. Les personnes qui bénéficient d’un statut élevé ou qui valorisent les hiérarchies peuvent instinctivement rejeter les mouvements qui remettent en question l’ordre établi.
3. La culpabilisation est-elle utile pour faire avancer les idées féministes ?
Pas toujours. La culpabilité peut engendrer une réaction de rejet. Une approche basée sur l’empathie, les bénéfices communs et le respect des besoins psychologiques fondamentaux s’avère souvent plus efficace.
4. L’égalité totale entre les sexes est-elle possible ?
L’égalité absolue est un idéal complexe, notamment en raison des biais cognitifs et des instincts évolutionnaires qui perçoivent les différences comme naturelles. Le féminisme pourrait viser une équité ajustée plutôt qu’une égalité stricte.
5. Comment favoriser la coopération entre hommes et femmes autour des enjeux féministes ?
La coopération émerge quand les groupes perçoivent un objectif commun. En favorisant des interactions positives et égalitaires, en insistant sur les bénéfices mutuels, le féminisme peut rassembler au lieu de diviser.
Marius François – Psychologue clinicien, Psychothérapeute, Hypnose, EMDR – Moulins (03)
Les obstacles du féminisme expliqués par un psychologue de Moulins






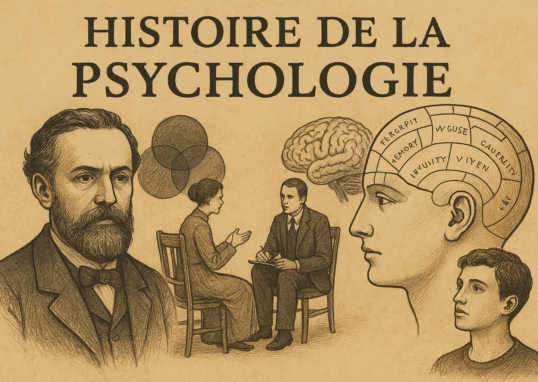
Merci François pour cet excellent article. Il est complet, très bien écrit et référencé. Il me reste une question à la lecture de la conclusion. Tu dis que le féminisme aurait à gagner d’adapter sa manière de s’exprimer, qu’il serait plus efficace en créant des ponts, en passant par une révolution douce. Je ne peux que me rallier à cette idée. Je n’ai rien contre la douceur. Mais tant d’injustices cumulées à travers les siècles peuvent elles s’exprimer avec douceur ? N’y a-t-il pas une rage légitime ? Et ne faut-il pas laisser cette puissance sortir au risque évidemment de brouiller son message? Et puis est-ce que c’est seulement le féminisme qui doit faire cet effort d’avoir une position d’ouverture et de créer des ponts ? Sujet passionnant qui ouvre mille réflexions. Merci à toi d’alimenter ma pensée de bon matin. Bonne journée
Merci pour ton commentaire Christelle. L’injustice provoque irrémédiablement un ressenti de frustration et la frustration peut s’exprimer de différentes manières, la colère y compris. Rappelons néanmoins que la légitimité est une notion subjective qui se base sur l’évaluation et le point de vue de chaque personne, c’est pourquoi je ne parle pas de légitimité. Cependant, la colère et/ou la rage trouveront un intérêt à s’exprimer en fonction de la façon de s’exprimer, c’est à dire bénéfique ou délétère. L’expression doit donc être sélectionnée en fonction de l’objectif visé : soulager un ressenti de frustration (alors une expression violente peut être suffisante) ou faire passer un message (il y a donc nécessité de préparer son discours pour éviter de braquer l’auditoire).
Il est parfaitement aberrant de penser qu’une victime doit faire des efforts pour faire reconnaitre sa position de victime et ainsi la faire évoluer. La cause soutenue par le féminisme est révolutionnaire et vise à changer bon nombre de mentalités. Il serait contre productif d’adopter la violence à cet effet. Cette violence provoquée par la frustration doit être dissociée de la solution choisie, au risque de se court-circuiter…
Merci pour avoir partagé ta réflexion Christelle, bonne journée à toi.